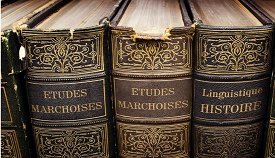| © 2017 |
| La Graphie |
|
LA GRAPHIE élément différent marchois / oc
C’est un élément important lorsqu’on parle d’une langue. Le français et l’anglais utilisent les mêmes lettres de l’alphabet mais n’en sont pas pour autant semblables. La graphie du marchois est phonologique avec des choix correspondant à son phonétisme particulier et aux multiples influences. Certains tentent de la faire disparaître au seul profit de la graphie occitane devenue cheval de Troie.
Les digrammes -LH et -NH Le marchois n’utilise pas la graphie occitane et ses digrammes caractéristiques (-lh pour écrire filhe ou bien -nh pour écrire montanha). On trouve même en gascon, le digramme -th qui correspond au « L » languedocien (castèl : castèth). Ce style est étranger à la graphie marchoise qui se rapproche plutôt de celle de langue d’oil.
L’alphabet L’occitan n’utilise pas toutes les lettres de l’alphabet : le K, Y et W sont considérés comme étrangères et ne s’emploient donc que pour des mots d’origine étrangère (whisky). En marchois, le Y existe et peut remplacer le « i » de la conjugaison (i/yo pourte) et ressemble fortement à la forme utilisée en vieux français pour le première personne du singulier qui s’écrivait jo. Le Y, si courant en langue d'oil, est aussi utilisé en marchois dans l’orthographe de certains mots comme les verbes youffa qui signifie crier (d’une façon aigue) ou bien encore ennoya (ennuyer). on le retrouve ausi dans des noms de communes.
La lettre H a existé en latin mais n'était plus prononcé en latin populaire (homo = homme, halare = souffler). Il s'agirait depuis d'une lettre rajoutée (période dite du « moyen français ») dans l'orthographe mais ne correspondant pas pour autant à un phonème. Ainsi, en marchois, le mot « houmme » s’écrit avec un H comme en français alors qu’en occitan il s’écrit « òme ».
Les accents Il en va de même avec la série d’accents graves ou aigus sur les voyelles qui caractérisent l’occitan.
Un parti pris affirmé en faveur de la graphie occitane : en quoi est-ce gênant ? Des exemples parmi d’autres :
Il suffit là encore de quelques recherches s’appuyant sur des textes écrits en marchois antérieurement à ces publications pour démontrer ces « erreurs » de graphie.
Dans ces textes, écrits entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle par des creusois qui maitrisaient au quotidien leur langue, aucune trace du « –lh » occitan, tous les verbes du premier groupe finissent par « a » à l’infinitif, etc…
Alors par quel miracle la graphie du marchois est-elle devenue occitane au 21ème siècle sous la plume de chercheurs occitans alors qu’elle ne l’était pas un siècle auparavant sous celles d’auteurs locaux ? Comment expliquer cette occitanisation à contre courant de l’Histoire alors que parallèlement le français a gagné de plus en plus de terrain ?
La graphie normalisée au service de la culture occitane La graphie normalisée, dite aussi graphie Alibertine, s’est imposé comme étant LA graphie occitane. C’est elle qu’appliquent à la lettre et sans se poser de questions les chercheurs occitans qui se sont intéressés à la Creuse. Au prétexte de revenir à une supposée « pureté » graphique qui daterait des troubadours (retour au XIIème siècle tout de même), les occitans ont donc mis au point une graphie qui se veut modernisée et avec une mission très précise : « (…) elle assure l'intercompréhension écrite immédiatement entre tous les dialectes. Une façon d’écrire pour 13 millions d'Occitans, et une prononciation propre aux particularités dialectales. Ainsi est évité le repli culturel sur un dialecte ». Le marchois étant considéré comme un sous-dialecte occitan, il doit donc passer sous le rouleau compresseur. A noter que le « repli culturel » est salué et salutaire lorsque ça concerne l’occitan mais mauvais pour les autres, dialectes ou sous-dialectes.
Mistral disait, au sujet du provençal (autre nom pour occitan au XIXe siècle), que « la langue, c'est la clef ». C’est cette clef que certains tentent de bricoler pour forcer les portes, pour faire en sorte que la Creuse et plus largement la Marche s’ouvrent à l'Occitanie et à cette culture occitane, certes riche et intéressante, que l’on veut nous imposer. C’est bien ce qu’on peut comprendre lorsque sont évoqués les avantages de cette graphie normalisée : « (...) celui d'assurer une vie culturelle occitane commune (…) elle restaure la dignité de la langue, en reprenant la graphie (modernisée) des troubadours, d'où son antériorité et son enracinement historique. Elle permet une saisie globale de notre culture ». Sources : site internet de l’IEO http://aune.lpl.univ-aix.fr/guests/ieo/ieo.html
Une application aveugle en Creuse La lecture de la partie consacrée à la langue dans l’ouvrage collectif de 2007 dédié à la Creuse (Encyclopédie Bonneton) est à ce sujet révélatrice : page 196 est reproduit une page du dictionnaire de Louis Queyrat datant de 1927. Evoquant, entre autre, cet auteur creusois, J-P Baldit et J-F Vignaud écrivent que « Cependant, ni Queyrat ni Montmerle n’ont de formation linguistique ni de conscience occitane : leur graphie s’en ressent leur analyse phonologique prête à sourire. Parfaits connaisseurs et usagers de leur parler, leur démarche reste localiste et ethnographique. ». Et pourquoi ces auteurs creusois n'auraient tout simplement une pratique linguistique et une vison des choses marchoise ?
Il ne peut en être ainsi. Les Creusois, qui sont Marchois, doivent au contraire être occitans, parler occitan et surtout l’écrire comme il faut.
Alors, il faut réécrire les histoires, les contes, les légendes, les chansons, les réviser dans le sens occitan pour enfin leur donner du sens… Et de proposer à la vente d’anciens ouvrages écrits auparavant en marchois mais réédités cette fois-ci… en graphie normalisée. Comme le marchois est, comme 90% des langues, une langue essentiellement orale et, qui plus est, qui a tendance à disparaître, la tâche devient moins ardue. On retrouve cette idée dans un texte, La normalisation graphique de l’occitan dans le Sud-Est. Introduction à la table ronde, écrit en 1992 par l'occitaniste René Merle, : « Trop souvent les "normatifs" attendent que l’on "débranche" le malade en état de survie artificielle : certains ne proclament-ils pas que la disparition des derniers occitanophones naturels permettra enfin l’imposition d’une forme unique de l’occitan normé et de sa graphie ? Imposition administrative autoritaire, à la catalane. » Nicolas QUINT estime de son côté que « les locuteurs marchois ne sont pas fiers de leur langue et ne se soucient quasiment pas de l’écrire ».
Dès lors, il est plus aisé, consciemment ou pas, d’« occitaniser » ce qui ne l’est pas. Une fois que c’est fait, il devient tellement facile de dire « regardez, c’est écrit comme en occitan, donc votre langue là, c’est de l’occitan ».
En Creuse, on peut parler d’une imposition administrative autoritaire et arbitraire de la graphie occitane. Ne dirait-on pas un simulacre de la IIIème république imposant le français au détriment des « patois » ? Avec ce même jacobinisme que des militants entendent appliquer au marchois alors qu’ils le dénoncent concernant l’occitan ?
La Creuse n’est pas un pays sous-développé, sans Histoire et sans culture. C’est une terre qui n’a certes jamais eu la renommée d’autres régions et, si elle reste un pays disposant de peu de richesses, ce n’est pas pour autant qu’il faut l’en dépouiller.
La graphie occitane, dite alibertine ou normalisée, ne nous concerne pas, ce n'est pas la peine de tenter de nous l'imposer.
Et si les idées valent souvent mieux que les hommes, il convient de préciser que Louis Alibert, auteur d'une Grammaire occitane et "père" de la graphie normalisée, par ailleurs pharmacien dans l'Aude, a été condamné, ainsi que sa femme, en février 1946 pour collaboration avec la Gestapo et dénonciation. Leur fils est mort sous l’uniforme de la Milice. « Alibert s’est réfugié corps et âme dans les bras de Vichy bercé par les sirènes régionalistes du régime. Plus encore, entraîné par la haine du radicalisme de l’entre-deux guerres, il s’est rangé aux côtés d’Adolf Hitler (…) Sa femme, comme lui, est emprisonnée pour avoir dénoncé par écrit des militants gaullistes de Montréal. Son unique fils, Henri, engagé volontaire en Allemagne est mort en 1943, le jour de ses trente ans. » Jacques Ressair, Alibert et l’illusion, journal Lo Lugarn N° 71, printemps 2000, Partit Nacionalista Occitan. Dans une Lettre au préfet, reproduite dans ce même journal ocitan, Alibert donne lui-même son parcours politique : « Depuis 1918, je suis abonné à l’Action Française et j’ai fait partie de la Ligue d’A.F. en qualité de sympathisant et de Ligueur. » « En compagnie de Mr Maurice Blanc et en qualité de secrétaire, j’ai fondé la section locale de la Légion des C. de Montréal et j’ai été exclu du comité, car j’étais en désaccord complet avec le Président Départemental Caillard parce que je voulais faire de notre section une véritable association de combat et de défense de la Révolution Nationale (ce qu’est aujourd’hui la milice). « Actuellement, je suis avec six ou sept de mes amis parmi le petit groupe de fidèles à la politique du Maréchal et du Président Laval. Je suis inscrit au groupe « Collaboration » depuis deux ans. » Alibert était donc membre de l’Action française, de la Légion des Combattants et du groupe Collaboration. La femme d’Alibert sera condamnée à dix années de travaux forcés pour avoir dénoncé des résistants et Alibert à cinq années de réclusion. Ils seront aussi frappés tous les deux de l’indignation nationale à vie.
Alors quel est le rapport avec son œuvre linguistique ? Aucun à première vue. Si ce n'est que d'autres figures des plus importantes (Mistral l’écrivain et Roumanille le théoricien et fondateur du Félibre) ont eu avant lui des parcours plus qu’équivoques avec l'Action française... cela ne fait bien sûr pas de tous les militants occitans des "fascistes" mais il reste troublant de voir trois personnalités aussi importantes du mouvement occitan avec un tel ciruculum vitae. Toutefois, « (…) Après 1945 (…), le flambeau de l’occitanisme est repris par des hommes de gauche, issus de la Résistance pour certains d’entre eux. Ils sont à l’origine de la création de l’Institut d’Etudes Occitanes, dont les activités vont de la recherche en linguistique, histoire, ethnographie à la réflexion sur la pédagogie, celle de la langue en particulier. » Jean-Pierre Albert, Patrimoine et ethnologie dans le Sud de la France, 2003. |
 |